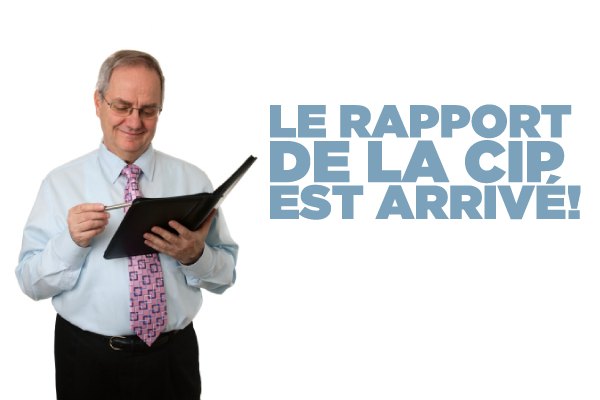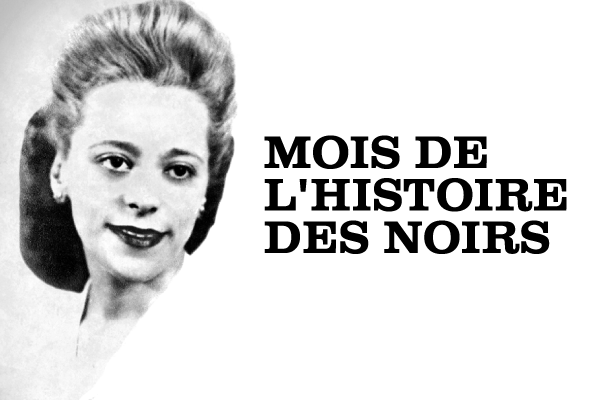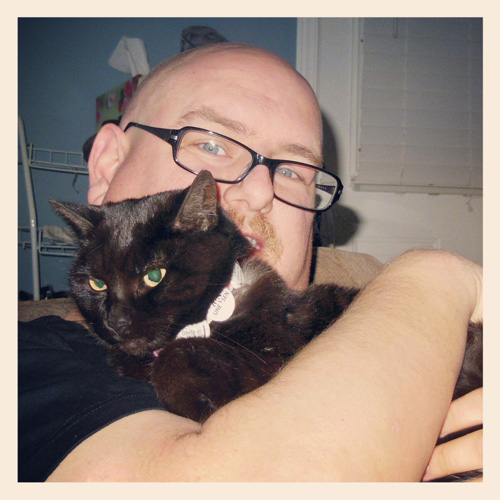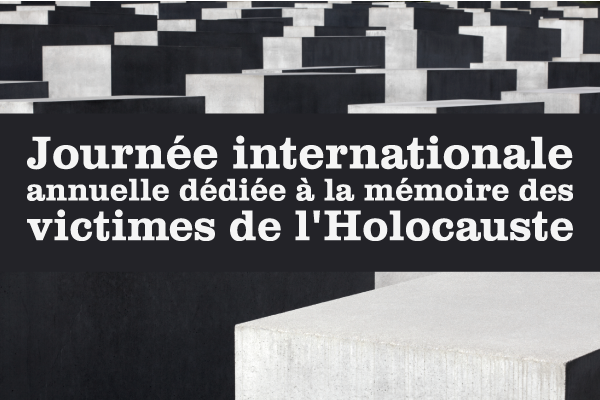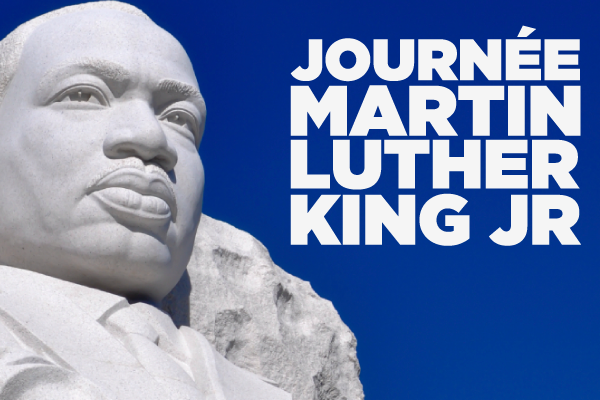« Leur mort laisse notre cœur en détresse »
C’est ce qui était écrit sur une carte qui a été remise à Jennifer Chieh Ho, la vice-présidente régionale du SEN pour la Colombie-Britannique et le Yukon, au cours de la marche commémorative des femmes qui a eu lieu la semaine dernière.
Pendant que les Canadiens étaient nombreux à mettre la dernière main à leurs projets pour la St-Valentin, bien d’autres ont marché dans les rues pour rendre hommage aux femmes disparues et assassinées au Canada. La première marche commémorative a eu lieu il y a 22 ans dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver.
Depuis dix ans, ces marches ont eu lieu dans plusieurs villes au Canada.
Selon Kristin Gilchrist, cofondatrice de Families of Sisters in Spirit et étudiante au doctorat au Département de sociologie à l’Université Carleton, ces marches ont pris une ampleur considérable grâce au travail important d’innombrables organisations communautaires.
« Ces organisations font un important travail de sensibilisation à la violence dans nos collectivités, plus particulièrement à la violence envers les femmes autochtones », a écrit Mme Gilchrist.
Cette année, Mme Chieh Ho et quelques membres de sa section locale ont participé à la marche, qui se tenait où tout a commencé : dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver. Elle a déclaré être particulièrement heureuse de voir un groupe si diversifié composé d’alliés venus manifester pour soutenir cette cause importante.
« Il y avait beaucoup de confrères et consœurs autochtones, mais aussi un nombre considérable d’hommes et de femmes de toutes les nationalités, de tous les âges, qui étaient là pour soutenir la cause », a-t-elle souligné.
« Au cours de la marche, nous sommes passés devant certains endroits où des femmes avaient été assassinées ou avaient été vues pour la dernière fois », a expliqué Mme Chieh Ho. « Nous avons pris un moment à chaque endroit pour rendre hommage à chacune de ces femmes. »
Mme Chieh Ho a aussi mentionné qu’une rose avait été déposée à chaque endroit : une rose rouge pour les femmes qui ont été assassinées, et une rose jaune pour les femmes disparues.
« J’ai été un peu choquée et attristée en me rendant compte à quel point nous nous sommes arrêtés souvent », a-t-elle ajouté.
L’Association des femmes autochtones du Canada possède une liste où figurent plus de 500 cas de femmes autochtones disparues et assassinées – et ce ne sont que les cas qu’elle peut confirmer.
Mme Gilchrist déclare que les femmes autochtones font face à de nombreux obstacles lorsqu’elles veulent se faire entendre.
« Les obstacles sont particulièrement apparents du fait que les alliés ne réussissent pas à créer des liens entre les divers militants qui luttent contre la violence, les organisations anticoloniales et tous ceux qui veulent que soient reconnues les responsabilités des colonisateurs », a écrit Mme Gilchrist.
Elle déclare que les femmes autochtones sont souvent entendues après coup ou totalement réduites au silence. De plus, bien souvent, les personnes qui mettent de l’avant leur propre programme s’attendent simplement à ce que ces femmes suivent sans rien dire.
« Ça se produit un peu trop souvent », a-t-elle déclaré.
Le gouvernement Harper continue de refuser que se tienne une enquête publique concernant les femmes autochtones disparues et assassinées.
Comme nous le disait Jennifer Lord de l’Association des femmes autochtones du Canada l’année dernière : « C’est ce que les familles veulent, une enquête publique ».
Il y a des photos de la marche commémorative de Vancouver sur FlickR.