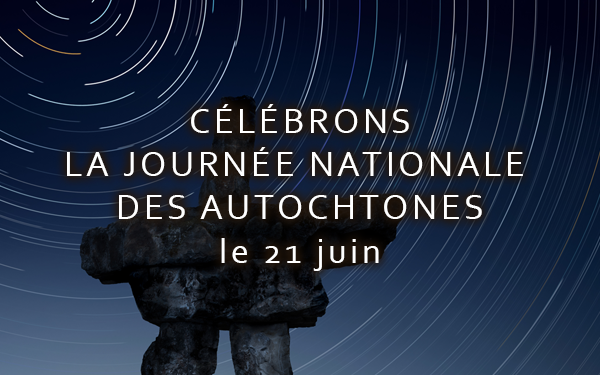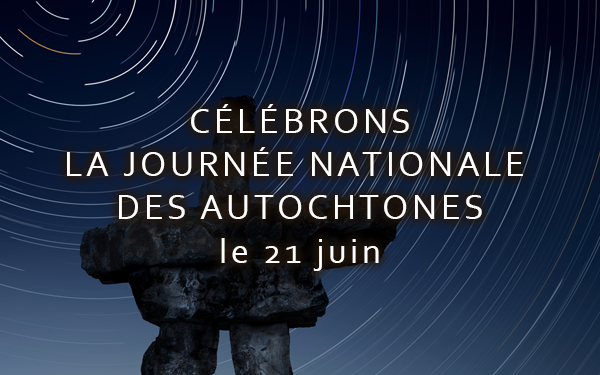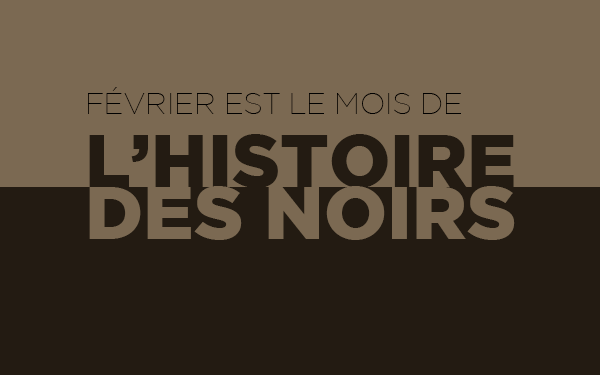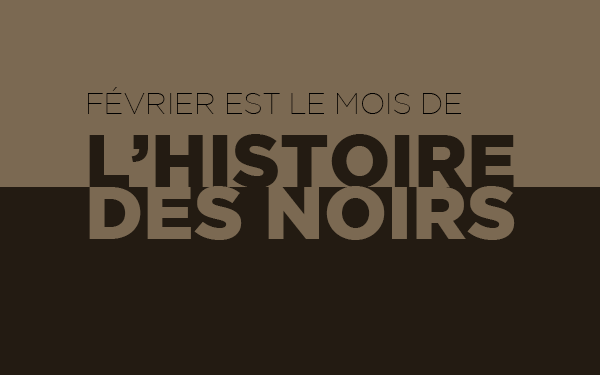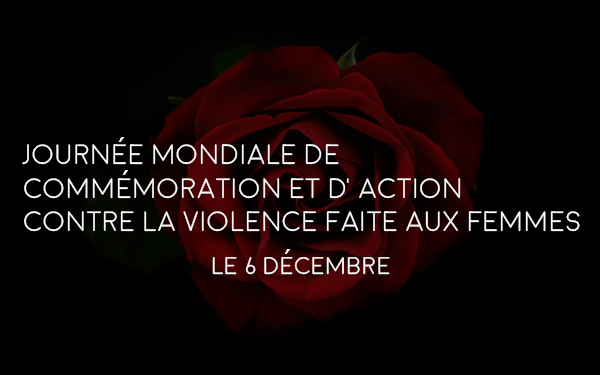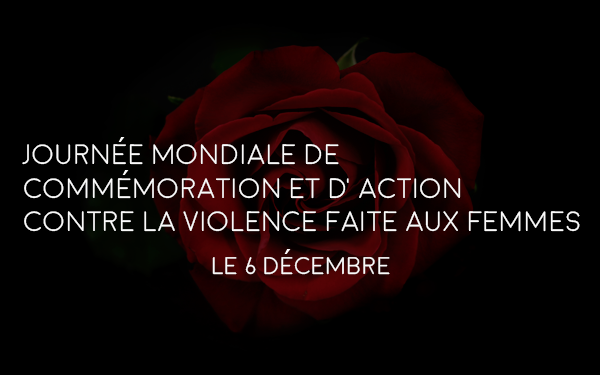Par Prabir Roy
La Journée internationale des personnes en situation de handicap (JIPH), fêtée annuellement le 3 décembre, est un puissant rappel à célébrer les réalisations et les contributions des personnes en situation de handicap. Proclamée en 1992 par l’Assemblée générale des Nations Unies, cette journée souligne également les défis persistants avec lesquels ces personnes composent. « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable », soit le thème de 2024, met l’accent sur une vérité absolue : les personnes en situation de handicap ne sont pas de simples participantes dans la lutte pour l’inclusivité; ce sont elles qui mènent la lutte. Les expériences qu’elles ont vécues, leur perspective, et leur détermination sont des éléments fondamentaux pour façonner des lieux de travail, des communautés, et des systèmes qui conviennent à tout le monde, de façon équitable.
Le militantisme syndical, un moteur de changement. En tant que dirigeant syndical et militant, je vois quotidiennement la façon dont les barrières systémiques inhibent les personnes en situation de handicap dans le lieu de travail, au Canada. En dépit de lois comme la Loi canadienne sur l’accessibilité, bon nombre de travailleurs peinent à avoir accès à des chances égales et à un traitement équitable. Les syndicats sont particulièrement bien positionnés pour combattre ces inégalités et lutter pour un avenir où l’inclusion des personnes en situation de handicap fait partie intégrante de chaque aspect du lieu de travail.
Les syndicats jouent un rôle critique dans le démantèlement de ces obstacles. Le rôle du militantisme syndical va au-delà de plaider pour l’accessibilité. Il consiste également à exiger le changement systémique, à favoriser l’équité, et à créer des lieux de travail propices aux débouchés gratifiants pour que les personnes en situation de handicap puissent diriger et s’épanouir. Ensemble, nous luttons solidairement contre l’exclusion et nous bâtissons une culture d’inclusion et de justice.
Faire tomber les barrières au Canada. Si le Canada a fait des progrès dans la promotion de l’accessibilité, des écarts majeurs subsistent : (i) le taux d’emploi des personnes en situation de handicap traîne derrière les moyennes nationales; (ii) bon nombre de lieux de travail ne sont pas entièrement accessibles, ce qui contribue à perpétuer l’exclusion; (iii) les rôles de direction dans les secteurs privé et public incluent rarement les personnes en situation de handicap, ce qui prive les organismes de perspectives diverses et d’idées innovatrices. Ces défis persistent non pas en raison d’un manque de solutions, mais plutôt en raison d’une absence de volonté de mettre ces solutions en pratique. Cela doit changer.
Helen Keller, une militante des droits des personnes en situation de handicap a un jour dit :
« Tout seuls, nous ne pouvons accomplir que très peu; ensemble, nous pouvons accomplir tellement de choses. »
Ses mots trouvent véritablement un écho dans le mouvement syndical, mettant ainsi l’accent sur le pouvoir de l’action collective afin de créer un changement important. De la même façon, Swami Vivekananda, un philosophe indien, nous rappelle la force intérieure :
« Tous les pouvoirs sont en vous; vous pouvez absolument tout réaliser. Croyez en cela et ne croyez pas que vous êtes faible. »
Ces citations nous inspirent à reconnaître la résilience et le potentiel des personnes en situation de handicap, et à nous unir en tant qu’alliés pour défendre leur leadership et leurs droits.
Selon moi, le leadership va au-delà d’occuper des postes de pouvoir; il est question d’influencer le changement et de façonner les politiques qui reflètent les expériences vécues des personnes qui sont touchées par ces politiques. Pour concrétiser cette vision, nous devons : (i) habiliter le leadership en appuyant les personnes en situation de handicap dans des rôles de leadership au sein de syndicats, de lieux de travail, et de collectivités afin de garantir que leur perspective façonne l’avenir; (ii) exiger des comptes en préconisant l’adoption de politiques et de pratiques qui vont au-delà de la conformité, et qui mettent plutôt l’accent sur l’équité, la dignité, et la participation gratifiante; et (iii) favoriser la collaboration en travaillant de concert —syndicats, employeurs, décideurs, et collectivités — pour lutter contre les barrières systémiques et créer des espaces véritablement inclusifs.
Alors que nous soulignons la JIPH 2024, j’invite les membres de syndicats, les alliés et l’ensemble des Canadiens à réfléchir sur le rôle qu’ils jouent dans la création d’une société véritablement inclusive. Reconnaissons le potentiel de leadership des personnes en situation de handicap, célébrons leurs contributions, et travaillons collectivement pour abattre les barrières systémiques.
Le rôle des syndicats a toujours été de favoriser le pouvoir collectif et la justice. En cette JIPH, renouvelons notre engagement envers un avenir où chaque individu, quelles que soient ses capacités, peut diriger, contribuer, et s’épanouir. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada qui valorise chaque voix, accepte véritablement l’inclusion, et ne laisse personne derrière.
Prabir Roy est le représentant national de l’équité pour les personnes handicapées du SEN.